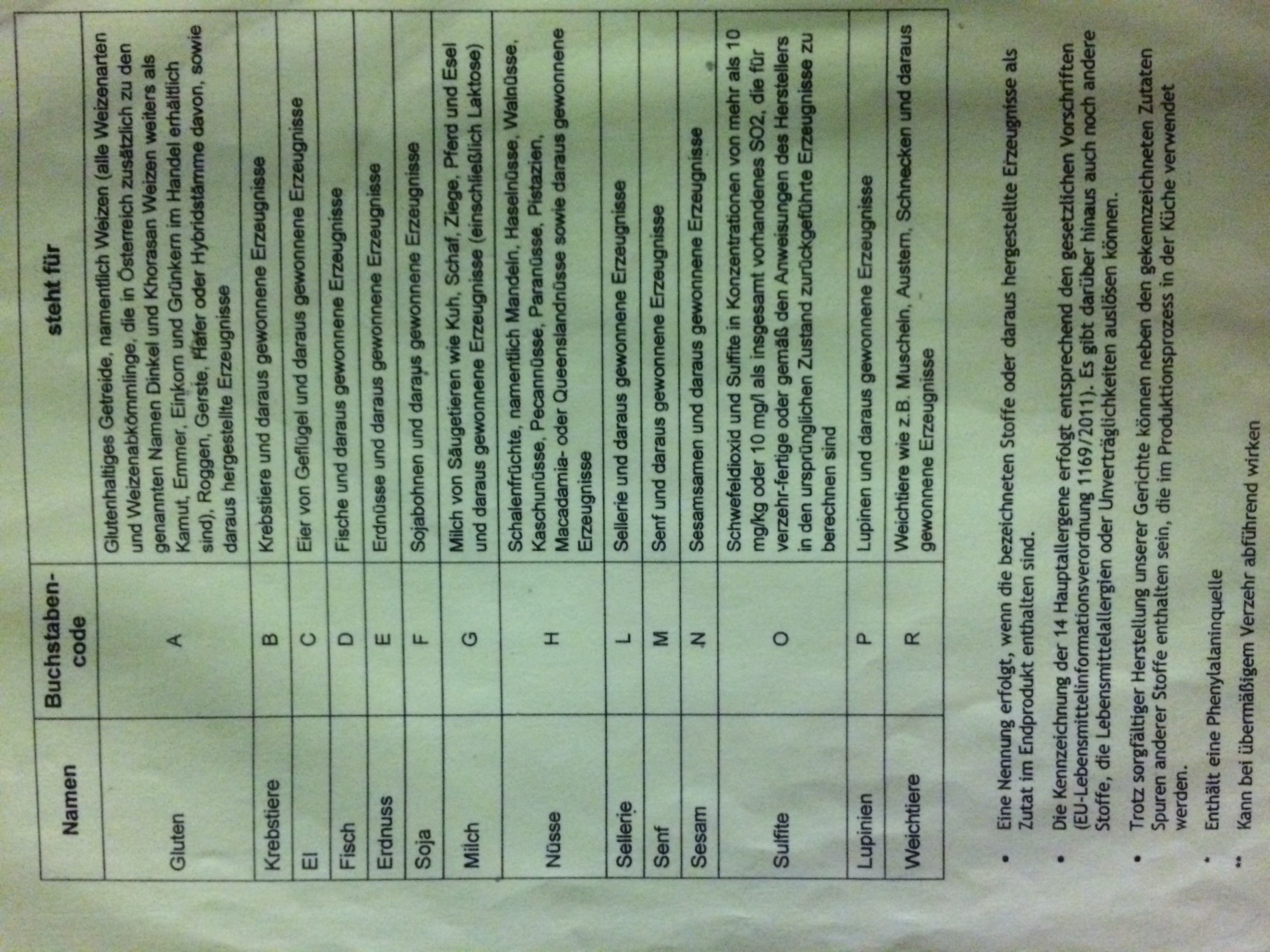Toujours pas d’internet. Il est une heure du matin (le 12 juillet, donc), j’écris cela dans TextEdit dans la couchette du haut des lits superposés. Il fait très chaud. Je viens d’ouvrir la fenêtre que nous avions décidé de laisser fermer après l’expérience bruyante de la nuit dernière. Je manque de courage pour écrire: trop d’impressions, trop de détails, et tout cela si trivial, si banal, si humain. Ecrire pour décrire, pour saisir, pour ordonner, pour ne pas oublier. Ecrire pour s’obliger à mettre de l’ordre, comme une discipline musculaire. Ecrire contre la paresse de se laisser entraîner par le flux. Mais c’est si long.
Le petit déjeuner est servi de 7h30 à 9h. Lorsque nous arrivons dans la salle à manger commune, celle-ci est déjà pleine de gens de tous âges, il y a autant de couples âgés (définissons âgé: cinquante ans et plus, cheveux gris ou rides) que de couples avec enfants en bas âge. La seule population peu représentée est celle des adolescents (quatorze à vingt ans). Il y a même des hommes seuls, jeunes ou moins jeunes, venus ici peut-être pour l’animation, la vie.
La salle bourdonne mais n’est pas excessivement bruyante, cela me réconforte étrangement (je veux dire que je ne m’y attendais pas) de voir ces têtes blondinettes barbouillées de fromage blanc. Pas de cris, pas de larmes, pas de caprices. (Il est peut-être trop tôt).
Nous nous installons sur la terrasse après avoir essuyé la table, il a plu cette nuit. Depuis plusieurs jours j’ai adopté le petit déjeuner muesli, fromage blanc et céréales, les céréales étant plus ou moins sophistiquées selon la classe de l’hôtel, ce qui signifie que plus l’hôtel est luxueux, plus les céréales sont variées et présentées peu transformées, proches de la graine nue.
Nous petitdéjeunons en préparant notre journée et en regardant les enfants jouer à la balançoire. Philipp, un blondinet de deux ans, semble particulièrement aventureux. En toute logique il devrait se prendre une balançoire dans la mâchoire mais cela ne semble inquiéter personne. C’est si reposant, cette façon darwinienne d’élever les enfants, sans adulte hystérique pour protéger ou interdire.
— C’est si tranquille et si heureux. Il ne manque plus qu’un meurtre.
O. manque de s’étouffer de rire dans son café.
— Mais si, tu sais bien, transpose il y a quatre-vingts ans dans les îles avec de vieux Anglais, c’est tout à fait Miss Marple.
Nous partons sans repasser par la chambre. Rive sud du lac. J’ai mis ma combinaison d’aviron (une seule pièce moulante intégrant short et haut débardeur) sous un short en jean et un haut gris afin de pouvoir faire du kayak le cas échéant. Le coup de soleil pris en montagne il y a quatre jours (ou cinq? nous avons perdu la notion du temps) dérougit à peine, il est à la fois très laid (un V foncé marqué sur la poitrine en dessous du cou contrastant avec la peau blanche) et douloureux (certains tissus ne sont pas supportables).
[…]
Je reprends ce récit toujours dans la couchette du haut mais à Vienne le 14 juillet, six heures du matin.
En suivant la rive droite du lac nous passons devant un parking et une pancarte «G. Mahler» : nous n'aurons donc même pas besoin de chercher. Nous nous garons, prenons le chemin. Il est neuf heures et quart. Nous montons vers la cabane (das Haüschen de Maiernigg) à travers la forêt, un quart d'heure de marche indique la pancarte. Nous croisons un homme avec deux chiens dont le noir, vieux, raide, marche avec peine.
Il fait bon, il fait frais, nous arrivons une demie-heure trop tôt à la cabane de Malher, elle est fermée. Elle est en dur, un peu plus grande que le chalet de Toblach. Ce qui est surprenant, c'est l'absence totale de perspective, de ligne de fuite: elle est au milieu des bois, la pente remonte en face des fenêtres. Je pense à ce que j'ai lu un jour, qu'il ne faut pas une belle vue à un créateur, cela distrait. Il faut des murs, des gravures fades. Mahler dormait-il sur place, y a-t-il un lit, nous ne le saurons pas car nous décidons de ne pas attendre, nous avons un programme chargé.
Nous sommes arrivés dans le musée Robert Musil pour l'ouverture. C'est une seule grande pièce, avec un premier renfoncement consacré à Ingeborg Bachmann et un second à Christine Lavant dont je n'avais jamais entendu parler (renseignement pris, un contact me dit que c'est un Trakl féminin).
Des photos, des lettres, des valises, une machine à écrire, toute une chronologie (une vie) appuyée sur des preuves. Musil est né ici mais n'y a passé qu'un an. Tout est en allemand et nous passons un temps si long dans ces pièces qu'à plusieurs reprises (quatre!) les personnes en charge de l'endroit (qui est aussi une bibliothèque-librairie-salon) viennent nous demander si tout va bien: mais que pouvons-nous faire si longtemps dans un endroit somme toute si petit?
Nous lisons, mademoiselle, monsieur, je lis en allemand et je ne lis pas vite. Musil apprend le crawl, nouvelle nage de l'entre-deux-guerre. Il écrit un texte sur la bêtise (en 38, il me semble: on devine qui il vise). Il fait ses études à l'école militaire de Mährisch, trois ans après que Rilke l'a quittée. (C'est l'expérience qui a inspiré
Törless). Il est chargé de trouver de jeunes auteurs inconnus pour la revue
Die Neue Rundschau.
La métamorphose de Kafka passe entre ses mains et aurait pu paraître dans la revue, mais les négociations échouent car Kafka refuse un racourcissement de sa nouvelle.
Je passe aux textes sur Bachmann, de grands panneaux imprimés qui reprennent peu ou prou ce que j'ai lu dans
Retour à Klagenfurt, le livre acheté autour de 1988-1989 qui a motivé ma venue ici. Je prends les panneaux en photos ainsi qu'un portrait de Nelly Sachs. J'en profite pour parler de Celan à O. (mais ce qui vient quand on présente un auteur, un poète, à quelqu'un qui ne le connaît pas et n'éprouve pas d'intérêt particulier, c'est toujours l'anecdote: Bachmann est morte brûlée, Celan s'est suicidé, Nelly Sachs, «connue de ceux qui la connaissent», a échangé une importante correspondance avec Celan, le tome 2 de
L'homme qans qualité paraît toujours neuf dans les livres d'occasion de Gibert: comment sortir de cela?
1.)
Mais O. lit tout, avec gentillesse (envers moi) et avec application; il prend les documents (des feuilles A4 photocopiées) qui nous sont donnés, et c’est avec l’un d’eux,
Literarturwandern - Auf den Spuren von Ingeborg Bachmann, que nous partons en balade dans la ville. Je me rends vite compte que
Retour à Klagenfurt m’a dit l’essentiel et que je pourrais l’utiliser pour commenter les lieux : place du nouveau marché avec le dragon qui est l’emblème de la ville et que l’on retrouve jusque sur les tickets de parking, l’avenue des ursulines (petit mystère : « pour les dictionnaires,
gasse serait une ruelle, une allée, mais sur le terrain, c’est belle et bien un boulevard ou une avenue. A moins que cela ne prenne ce sens que composé (
Ursulinengasse, avenue des Ursulines) ? Nous passons devant le théâtre (à voir l’automne, dit Bachmann dit Uwe Johnson) (« c’est un banc — Non, ce n’est pas un banc — Si c’est un banc… ah non » (sculpture moderne)), suivons la rue Radetzky tout du long (et comme cette promenade sur les pas de Bachmann n’est qu’un prétexte à l’errance, oublions de faire un crochet devant la maison de ses parents au 26 de la Henselstraße).
Vendredi 28 juillet, Anvers, six heures du matin. Insomnie peut-être due à un dessert de trop ou à l’absence de climatisation. On s’habitue au confort. Je repends cette narration indéfiniment remise, parce que les ciels sont trop beaux, parce qu’il n’est pas possible de taper en voiture en écoutant des podcasts. Je suis tellement en retard. Combien de jours pour tout raconter si l’on ne raconte pas au fur à mesure ?
La Radetzkystraße est bordée de belles demeures bourgeoises. Vers sa fin les trottoirs se chargent de fleuristes dans la version jardinière, c’est-à-dire qui vendent des graines et des plants, et non des fleurs coupées (toute l’Autriche est ainsi : jamais vu autant de pépiniéristes et vendeurs de matériel de jardinage aux abords des villes qu’ici). Elle aboutit au pied d’une colline couronnée d’une église, la Kreuzbergl. Nous grimpons sous le soleil de plus en plus chaud le chemin de croix dont les stations sont des mosaïques grandeur nature (je ne reconnais pas toutes les stations, sans que je sache s’il s’agit d’une version autrichienne du chemin de croix ou d’une version locale).
La suite de la promenade nous emmènerait au bord du lac et le descriptif nous prévient de prévoir une heure à une heure et demie. Nous rebroussons chemin.
Faux Hugo à l’angle de la Karnerstraße et de la Radetzkystraße : ils n’ont pas de menthe donc ne peuvent nous faire un Hugo, nous expliquent-ils. Nous buvons un mélange de vin blanc et d’eau pétillante. Retour en ville, monument commémorant le référendum de 1920 qui a choisi de rattacher la Carinthie à l’Autriche et non à la Slovénie (
une recherche plus tard, j’apprends que ce qui est en jeu, c’est le sort des Slovènes et de la langue slovène. La Carinthie est un bastion du conservatisme germanophone pour ne pas dire de l’extrême-droite, aujourd’hui encore. J'ignorais ce fait mais je me souviens m’être interrogée devant le nombre de panneaux bilingues. Cela permet de comprendre le dégoût de Bachmann envers sa ville alors que rien ne l’explique quand on se promène dans cette ville souriante.), ancienne place (Alter Platz).
Nous déjeunons dans une petite rue d'un plat du jour proposé par un boucher-traiteur en contemplant l'élégance des Autrichiens (cela rend le débraillé des touristes toujours un peu honteux), puis nous entrons à St Egid pour y chercher la tombe de Julien Green. Elle se présente comme une grande dalle de marbre au sol dans une des chapelles du bas-côté de droite. Elle est parfaitement intégrée au dallage comme si elle était ici de toute éternité. Au mur une autre plaque présente un poème de Green. Mais comment a-t-il obtenu cela? Des gens prient, je n’ose déambuler d’autant que je suis en short (l’Italie m’a enseigné une retenue vestimentaire dans les églises que je n’avais pas apprise en France — et je m’y sens tenue en tant que touriste, visiteuse), mais il me semble qu’aucune autre tombe n’est ainsi présente dans l’église, y compris des tombes de prélats.
Deux Hugo dos à St Egid, retour à la voiture, le ciel se couvre, atmosphère lourde et orageuse, direction le cimetière (
Friedhof, maison de la paix, maison du repos : dernière demeure) d’Annabilch que je sais être près de l’aéroport, toujours grâce à Uwe Johnson.
Un plan du cimetière indiquant les tombes « remarquables » se trouvent à l’extérieur de l’enceinte, à gauche des bâtiments administratifs et du crématorium (comme nous sommes entrés par la droite, nous avons erré), celle de Bachmann est tout au fond, dans la partie opposée à l’entrée. Sont enterrés avec elle son père et sa mère — son père mort la même année, 1973. Avant ou après elle ?
J’ai vu ce que j’étais venue voir à Klagenfurt. Direction le lac pour rechercher de quoi sortir en canoë.
Nous avons beaucoup erré : rive nord du lac, nous avons suivi en voiture l’allée le long des deux clubs d’aviron jusqu’à nous heurter à une impasse ; rive ouest, à pied cette fois, nous avons interrogé la caissière de l’entrée de la plage, en face du camping, un gigantesque complexe pour lequel existent une carte famille et une carte annuelle — elle ne savait rien, comme plus tôt les employés du cimetière ne savaient rien — je crois qu’elle était fatiguée ou indifférente, comment peut-on s’intéresser si peu à sa ville ? J’ai insisté pour poursuivre le long de la plage jusqu’aux mâts entraperçus plus loin, et là, dans un endroit tranquille et gazonné, il nous a semblé, il a semblé à O. qui posait les questions en allemand, qu’il était trop tard pour ce soir (il était cinq heures, mais quel est ce monde qui se couche avec les poules ?) mais que si nous venions demain matin à neuf heures, nous pourrions louer un canoë.
Plus loin un château, le château de Maria Loretto et à la pointe s’avançant dans le lac un restaurant — fermé, déception.
Rebrousser chemin le long du canal. Club de kayak en face, de « vrai » kayak,
ie sportif et non touristique ; musculature du kayakeur bronzé qui remonte le canal torse nu, sort de son bateau et se penche, tel Tarzan, se saisit de l’embarcation d’une main et part vers le club d’un pas souple (vision cinématographique qui nous fait rire dans son irréalité) ; reprendre la voiture, chercher un restaurant sur Yelp (Yelp et Waze, les deux mamelles de notre voyage). Si l'auberge de jeunesse dîne à six heures, il nous faut supposer que les Autrichiens dînent tôt.
Garer la voiture est toujours angoissant (ce doit être un pli parisien, car en réalité nous ne rencontrerons de problème nulle part) : y aura-t-il de la place proche de l'endroit où nous allons ? Aurons-nous assez de monnaie pour payer le parcmètre ? C'est pourquoi O. rentre spontanément dans le premier parking qui semble proche de notre destination. Nous découvrons ensuite qu'il s'agit du parking d'un centre commercial, il paraît fermer à neuf heures.
C'est alors que j'ai vu O. devenir fou. Il a un grand sens de l'orientation et se repère très vite. La sortie du parking donnait dans le centre commercial. Il a cherché à sortir du centre commercial, arpentant le second étage puis le premier, de plus en plus vite, ne trouvant rien, grommelant « ce n'est pas possible, le parking ne peut pas être la seule sortie », s'arrêtant pour interroger les murs ou l'horizon du regard, de plus en plus proche d'un état qui ressemblait à de la panique, la panique de la raison confrontée à l'absurde.
Nous avons fini par trouver une sortie pour les piétons. En longeant le bâtiment de l'extérieur, il est apparu qu'il n'y en avait que deux. Ce centre commercial est installé dans les anciens bâtiments d'une industrie du XIXe siècle : je suppose qu'on a évité de défigurer le bâtiment en y perçant des portes, mais je me demande comment les normes de sécurité en cas d'incendie. Ce centre commercial s'appelle Arcadie ; je fais remarquer à O. que dans les livres ou films de SF, ce nom est toujours mauvais signe, c'est toujours l'enfer sous un aspect souriant.
Nous allons dîner au
Bacchus. Il pleut, nous ne pouvons nous installer en terrasse. Le serveur est très aimable et séduit O. en lui disant que son allemand était tel qu'il n'avait pas compris que nous étions français. Nous prenons une spécialité de la maison prévue officiellement pour deux mais qui conviendrait à trois. Nous découvrons que "Mineralwasser" signifie ici pétillante. "Sprudelwasser" paraît inconnu en Autriche.
Nous rentrons préparer nos valises : demain, nous avons prévu de faire du canoë avant de rejoindre Vienne.
Note
1 : Si alors Swann cherchait à lui apprendre en quoi consistait la beauté artistique, comment il fallait admirer les vers ou les tableaux, au bout d’un instant elle cessait d’écouter, disant : « Oui... je ne me figurais pas que c’était comme cela. » Et il sentait qu’elle éprouvait une telle déception qu’il préférait mentir en lui disant que tout cela n’était rien, que ce n’était encore que des bagatelles, qu’il n’avait pas le temps d’aborder le fond, qu’il y avait autre chose. Mais elle lui disait vivement : « Autre chose ? quoi ?... Dis-le alors », mais il ne le disait pas, sachant combien cela lui paraîtrait mince et différent de ce qu’elle espérait, moins sensationnel et moins touchant, […]. Proust,
Un amour de Swann